
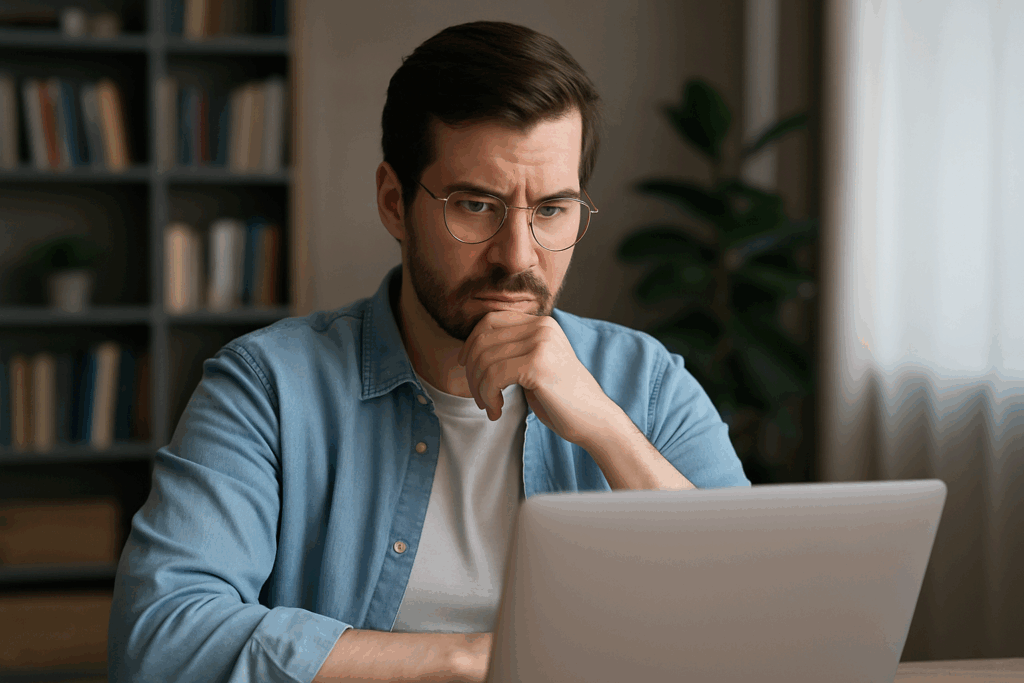
À l’ère du numérique, nos vies sont de plus en plus intégrées à des services en ligne : messagerie, réseaux sociaux, stockage en nuage, plateformes professionnelles… Mais peu d’entre nous prennent le temps de se poser une question pourtant essentielle : où sont réellement hébergées nos données personnelles ? Et surtout, qui y a accès ?
La majorité des services que nous utilisons quotidiennement — Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple, etc. — sont américains. Ce qui signifie que plus de 80 % de nos données personnelles sont stockées aux États-Unis ou sous le contrôle de sociétés américaines, même si les serveurs se trouvent parfois physiquement ailleurs.
Cette situation pose plusieurs problèmes importants, à commencer par l’extraterritorialité des lois américaines. Depuis 2018, le Cloud Act autorise les autorités des États-Unis à accéder aux données détenues par des entreprises américaines, même si ces données sont hébergées en dehors du territoire américain.
Autrement dit, nos données ne sont pas pleinement protégées par les lois locales ou européennes, même si nous vivons au Québec, en France ou ailleurs.
Malgré ces enjeux, une question demeure : sommes-nous réellement préoccupés par cette réalité ? La réponse semble nuancée. Beaucoup de citoyens disent ne pas se sentir concernés ou ne pas avoir « d’informations sensibles à cacher ». C’est une réaction compréhensible, mais malheureusement trompeuse.
Ce n’est pas uniquement une question de vie privée. C’est aussi une question de :
Il ne s’agit pas de céder à la paranoïa, mais de faire preuve de lucidité. Si les entreprises, les gouvernements et les institutions se préoccupent de la localisation des données, pourquoi les citoyens ne le feraient-ils pas eux aussi ?
Heureusement, des alternatives existent : des services de courriel, de cloud ou de collaboration développés au Québec, en France ou ailleurs en Europe, qui respectent davantage notre vie privée et nos lois locales.
La localisation des données personnelles n’est pas une affaire réservée aux experts en cybersécurité. C’est une question de société. Elle touche à nos libertés, à notre autonomie, à notre avenir numérique.
Et vous, êtes-vous à l’aise avec le fait que la majorité de vos données soient potentiellement accessibles à une puissance étrangère ?
#DonnéesPersonnelles #SouverainetéNumérique #ViePrivée #CloudSouverain



Rencontrez Charles Groleau, un expert-conseil chevronné dans le domaine de la conformité à la nouvelle Loi 25 du Québec sur la protection des données personnelles.
Avec une compréhension approfondie des nuances juridiques et une approche proactive, Charles est votre allié de confiance pour naviguer à travers les exigences réglementaires complexes et garantir que votre entreprise soit en parfaite conformité.